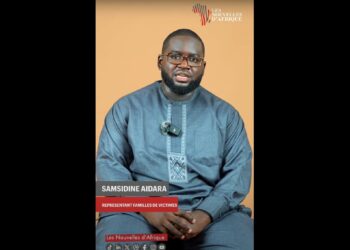Depuis septembre 2025, le corridor Dakar–Bamako, colonne vertébrale du commerce ouest-africain, est asphyxié par un blocus imposé par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM). Une situation sans précédent, qui menace directement l’économie malienne mais aussi, et surtout, l’équilibre macroéconomique du Sénégal. L’économiste Dr Serigne Moussa Dia, enseignant-chercheur dans les universités sénégalaises, décrypte pour Lesnouvellesdafrique.infos les conséquences économiques de ce “jihad économique” mené contre le corridor.
Une asphyxie programmée du commerce régional
« Le JNIM ne mène pas seulement une guerre idéologique, il mène désormais une guerre économique », explique le Dr Dia.
Le groupe djihadiste, actif au Mali, a imposé début septembre un embargo sur les flux de carburant et les convois commerciaux reliant Dakar à Bamako. Attaques de camions-citernes, destruction d’infrastructures logistiques, barrages et enlèvements : une stratégie d’étranglement redoutablement efficace, qui bloque plus de 70 % des importations maliennes.
Selon les données compilées par le Timbuktu Institute, plus de 241 attaques ont été recensées entre janvier et octobre 2025, contre 124 en 2024. Une intensification de 94 % qui traduit, selon Dr Dia, « un basculement vers une stratégie de jihad économique délibéré ».
Le Mali, victime directe – mais le Sénégal, grand perdant économique
Pour le Mali, les effets sont immédiats : pénuries de carburant, suspension des cours dans les écoles, paralysie des transports. Mais le Sénégal, principal fournisseur de son voisin, encaisse déjà de lourdes pertes.
« Le Mali est notre premier partenaire commercial africain, rappelle Dr Dia. En 2024, il a absorbé plus de 802 milliards de FCFA d’exportations sénégalaises, soit plus de 55 % de nos ventes vers l’Afrique et 21 % de nos exportations totales. »
Cette dépendance commerciale, souvent sous-estimée, expose gravement le Sénégal. Le Port autonome de Dakar (PAD), plaque tournante du commerce malien, voit ses activités s’effondrer : les flux quotidiens de 300 à 400 camions vers le Mali avant septembre sont aujourd’hui quasi nuls.
« Si la situation perdure, les pertes pourraient atteindre 400 milliards de francs CFA pour le port et le fisc sénégalais », alerte l’économiste.
Transport et logistique : le secteur au bord du gouffre
Le premier maillon brisé est celui du transport routier. Plusieurs compagnies sénégalaises et maliennes ont suspendu leurs activités après l’enlèvement de six routiers sénégalais en septembre.
« L’impact humain et financier est dramatique », souligne Dr Dia. « Les transporteurs n’assurent plus les trajets, les primes d’assurance explosent, et les opérateurs se retirent. Nous assistons à une paralysie totale des flux commerciaux. »
Cette rupture crée des “goulots d’étranglement” qui se répercutent sur les chaînes d’approvisionnement. Les produits sénégalais – hydrocarbures, ciment, denrées alimentaires – ne circulent plus.
Résultat : une contraction du commerce bilatéral et une montée des prix au Mali, tandis que les entreprises sénégalaises voient leurs stocks s’accumuler.
Lire aussi : Djihad économique au Mali : l’arme fatale du JNIM? (Contribution)
Une triple crise : économique, fiscale et sécuritaire
Selon le Dr Dia, le blocus agit comme un choc macroéconomique à trois niveaux :
_ Économique : effondrement des flux d’exportation et pertes portuaires estimées à plusieurs centaines de milliards de FCFA.
_ Fiscale : baisse des recettes douanières et de la fiscalité commerciale, qui financent une part majeure du budget de l’État sénégalais.
_ Sécuritaire : risque de contagion de l’instabilité malienne vers le Sénégal oriental, avec des mouvements de populations et une infiltration potentielle de groupes armés.
« Ce n’est pas seulement un blocus, c’est une attaque systémique contre l’intégration économique ouest-africaine », martèle l’économiste.
Des scénarios préoccupants
À court terme (3 à 6 mois), le Dr Dia anticipe une contraction du secteur exportateur et une perte mensuelle de plusieurs dizaines de milliards de FCFA pour le Sénégal.
À moyen terme (6 à 12 mois), « les ports concurrents comme Abidjan ou Conakry capteront les parts de marché maliennes perdues par Dakar ».
Et à long terme, prévient-il, « un Mali économiquement asphyxié pourrait devenir un foyer d’instabilité régionale, avec un coût sécuritaire et humanitaire colossal ».
Une réponse régionale urgente
Pour Dr Serigne Moussa Dia, le moment est venu d’abandonner les réponses ponctuelles : « L’ère des solutions ad hoc est terminée. Ce blocus révèle l’urgence d’une coordination régionale entre les États de la CEDEAO pour sécuriser les corridors commerciaux, mutualiser les efforts militaires et repenser la logistique régionale. »
Sans cela, conclut-il, le Sénégal risque de perdre non seulement un partenaire commercial majeur, mais aussi une part essentielle de sa stabilité économique.