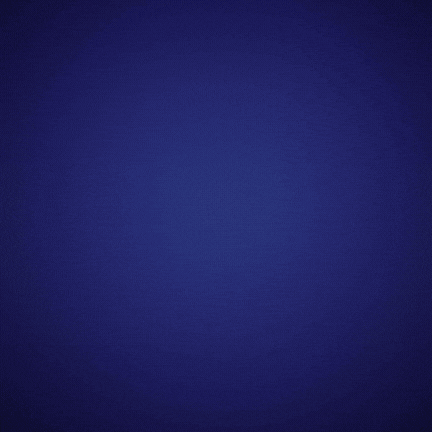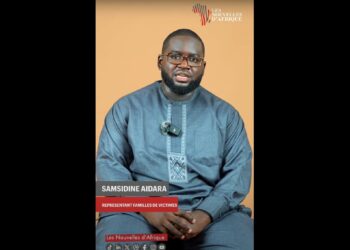Depuis fin octobre, Issa Tchiroma Bakary, vainqueur autoproclamé de la présidentielle camerounaise du 12 octobre et principal adversaire de Paul Biya, séjourne dans l’État d’Adamawa, au Nigeria, à quelques kilomètres de la frontière camerounaise. Selon Africa Intelligence, il est arrivé à Yola autour du 29 octobre et loge dans une résidence mise à disposition par un de ses soutiens.
Peu après son arrivée, la National Intelligence Agency (NIA), le renseignement extérieur nigérian, l’a interrogé sur ses intentions et lui a demandé de ne pas communiquer depuis le Nigeria. Il est actuellement placé sous surveillance, sous la responsabilité de Mohammed Mohammed, le maître-espion nigérian.
Issa Tchiroma Bakary entretient des liens historiques avec le Nigeria, notamment avec sa ville natale de Garoua (Adamaoua), anciennement sous l’autorité de l’émirat de l’Adamawa. Il a également des contacts avec d’autres chefs traditionnels nigérians, dont le puissant émir de Kano, Muhammadu Sanusi II.
Pour l’heure, aucun mandat d’arrêt n’a été émis par Yaoundé. Si tel était le cas, Abuja pourrait être contraint d’extrader l’opposant en vertu des accords judiciaires entre les deux pays, ce que le Nigeria souhaite éviter pour ne pas être impliqué dans la crise post-électorale camerounaise. À titre de comparaison, en janvier 2018, le Nigeria avait arrêté et extradé Sisiku Julius Ayuk Tabe, leader sécessionniste anglophone.
Au Cameroun, l’entourage de Paul Biya reste divisé sur la conduite à tenir. Certains appellent à l’apaisement et à la tenue du processus électoral menant à l’investiture du président le 6 novembre, tandis que d’autres réclament l’arrestation de Tchiroma Bakary, arguant qu’il viole la loi électorale en contestant le résultat officiel. Fin octobre, trois de ses soutiens ont déjà été arrêtés : Anicet Ekane, Djeukam Tchameni et Jean Calvin Aba’a Oyono.
Une arrestation d’Issa Tchiroma pourrait exacerber les tensions internes et isoler le Cameroun sur la scène internationale. En 2019, l’interpellation de l’opposant Maurice Kamto avait déjà provoqué des réactions diplomatiques, notamment des États-Unis.