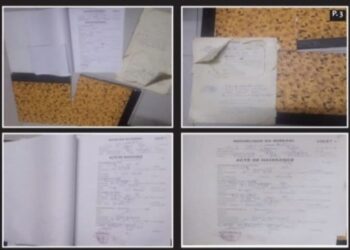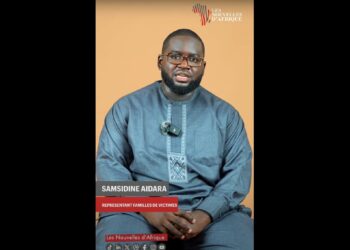Dans un entretien exclusif accordé aux Nouvelles d’Afrique, Bacary Samb, directeur exécutif du Timbuktu Institute, revient sur les conclusions du rapport publié le 28 avril. Il alerte sur l’avancée du groupe jihadiste JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin) vers le Sénégal et la Mauritanie, non pas seulement par des offensives militaires, mais surtout par une stratégie d’infiltration économique et communautaire.
Pourquoi ce rapport ?
Ce rapport a été motivé par le fait de documenter l’avancée du JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin) dont on parle beaucoup dans la zone des trois frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger, mais qui a été assez peu étudiée dans son avancée vers l’Ouest du Mali, c’est-à-dire vers l’Est du Sénégal et le Sud de la Mauritanie.
Ce rapport vise aussi à montrer que le JNIM, bien que n’étant pas dans une logique d’attaques successives, est en train de travailler à l’infiltration des réseaux économiques et des communautés, afin de pouvoir, le moment venu, mobiliser, recruter et accélérer ses activités dans cette partie du Mali.
Qu’est-ce qui explique cette volonté d’expansion vers d’autres États d’Afrique de l’Ouest ?
Je crois que le JNIM est dans une logique d’expansion, mais aussi dans une logique de recherche de ressources. Ces ressources, on les connaît : l’or et l’orpaillage, tout le monde sait que cette région est riche en or, jusqu’à Kédougou au Sénégal, mais aussi le trafic de bois, de bétail, etc. Tout cela sert à financer ses actions dans les fronts prioritaires qui sont aujourd’hui le centre du Mali, la région de Tillabéri au Niger et l’Est du Burkina Faso.
Pour alimenter cela, le JNIM a besoin de ressources, mais aussi d’affaiblir certains États de la région, notamment le Mali, déjà fragilisé, surtout depuis l’arrivée du groupe paramilitaire Wagner.
Le JNIM avance rapidement vers les frontières sénégalaises. Faut-il avoir peur ?
C’est à 1,3 km du Sénégal, à Diboli. Oui, le JNIM est dans une logique d’avancée. Mais il ne faut pas s’arrêter à ce fait spectaculaire. Lorsqu’il attaque près du Sénégal, il mène en parallèle un autre travail : l’infiltration des communautés et des sociétés. Et c’est cela le plus important. Aujourd’hui, des zones de la région de Kayes, comme Sandaré et Ilmanyé, deviennent prioritaires pour comprendre les enjeux. Il faut en savoir plus sur le niveau d’infiltration des communautés et les stratégies du JNIM, qui consistent souvent à exploiter des griefs socio-politiques. Leur stratégie repose sur trois piliers : profiter du déficit de présence et de gouvernance étatique ; exploiter les frustrations communautaires ; et instrumentaliser ces griefs pour recruter et pénétrer socialement ces pays.
Le Sénégal est-il préparé à la riposte ?
Je pense que depuis la crise malienne, le Sénégal s’est préparé à travers ce que j’appelle une stratégie mixte. Elle consiste à renforcer la sécurité aux frontières, créer de nouveaux camps militaires à Goudiry, renforcer la gendarmerie, les GRACIs, et mettre en place un système de renseignement de plus en plus sophistiqué. Mais aussi à travailler sur la résilience.
Des programmes communautaires comme le PUDC ou le PUMA ont contribué, sans le dire, à lutter contre la marginalisation territoriale, notamment dans les zones exposées, proches de pays déjà fortement touchés par le jihadisme, comme le Mali.
Faut-il faire bloc pour contrer le terrorisme en Afrique ?
La question sécuritaire n’a jamais été une question qu’un seul État peut gérer. Le terrorisme est un phénomène transnational et transfrontalier. Aucun État au monde ne peut lutter seul. On l’a vu avec le Mali : le débordement a très vite touché le Burkina Faso et le Niger. Les États doivent unir leurs efforts.
Mais il faut aussi être juste vis-à-vis de la CEDEAO. Aujourd’hui, on critique beaucoup cette organisation, mais il faut rappeler qu’elle a été dépossédée de la question sécuritaire au profit du G5 Sahel. Pendant près de dix ans, le G5 a mobilisé les partenaires et les ressources, en se focalisant sur le Sahel central (Mali, Niger, Burkina, Tchad, Mauritanie).
Ce choix a contribué à affaiblir l’architecture régionale de sécurité. La CEDEAO n’a pas eu les moyens, car l’attention et les financements se sont concentrés ailleurs. Finalement, le G5 Sahel n’a pas fonctionné, et il est urgent de redonner à la CEDEAO sa place dans la lutte contre le terrorisme.