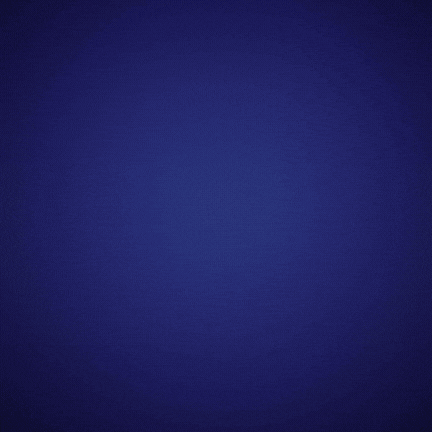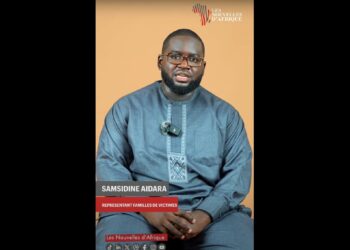Le 22 mars, qui coïncide avec la journée mondiale de l’eau, est l’occasion de nous rappeler l’importance vitale de cette ressource précieuse. Si cette année, le thème mondial place la préservation des glaciers au cœur, en Afrique, la problématique reste l’accès à l’eau potable et l’assainissement selon Alassane Samoura.
Il est le fondateur du musée de l’eau de Loumbila, localité située à 25 km de Ouagadougou, un lieu qui transcende les mythes.
lesnouvellesdafrique.info (LNA) : ce 22 mars est célébrée la journée mondiale de l’eau. Que vous inspire le thème du Burkina Faso pour cette année qui tourne autour de la préservation des ressources en eau, alors que celui mondial est « la préservation des glaciers »?
Alassane Samoura : il faut savoir que le 22 mars a été retenu par le système des Nations unies depuis 1993 pour célébrer la journée mondiale de l’eau. L’objectif pour l’ONU est que les acteurs de chaque pays, société civile, décideurs et associations, aient un regard particulier sur l’eau, notamment celui lié à la thématique. Chacun est libre de choisir un thème avec la réalité de son pays suivant le contexte qu’il défend. Au Burkina Faso, cette année, le thème « préservation des ressources en eau, gage d’une sécurité alimentaire et d’une résilience climatique » est assez éloquent, car il pose trois thématiques que sont celles de l’eau, celle de la sécurité alimentaire et la résilience climatique. Mais tout ceci est sous-tendu par la grande problématique de l’eau. L’eau est inhérente à la sécurité alimentaire et c’est elle qui peut aider à ce qu’il ait une résilience climatique. Aujourd’hui, il est du devoir d’un pays comme le Burkina de réfléchir à comment accéder à l’autosuffisance alimentaire, et pour cela, il faut suffisamment d’eau. Ou encore, pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut trouver des recettes endogènes qui permettent d’atténuer les chaleurs. Actuellement, nous sommes en pleine période de chaleur au Burkina, et il est très difficile pour les populations de vivre avec des températures avoisinant les 35 à 42 degrés souvent. Je pense qu’il est important de trouver des solutions. Depuis 1984, le gouvernement travaille sur comment parer à cela, car vous savez que nous sommes un pays très sec. Il existe des potentialités, des initiatives qui se développent, comme les barrages qui permettent de mieux exploiter l’eau. Aussi, les petites retenues d’eau peuvent être utilisées à bon escient pour faire de l’agriculture. Donc, il faut que les gens comprennent que l’eau est à la base d’un grand développement dans un pays désertique comme le Burkina Faso. Donc, je suis d’avis que la question des préservations doit devenir quelque chose de concret, une réalité pour le monde entier.
LNA : comment le musée de l’eau compte d’ailleurs marquer cette journée mondiale dédiée à l’eau ? Pouvez-vous revenir sur l’activité phare de votre programme, à savoir la procession des marcheurs ?
Alassane Samoura : cette année comme pour les précédentes, nous organisons des activités en lien avec la journée mondiale de l’eau. Nos réflexions ont porté sur les grandes questions de corvées d’eau. Pourquoi ? Selon les statistiques, les femmes marchent environ 5 km pour ramener une certaine quantité d’eau, et cela sur 7 à 8 h de temps. C’est énorme, fatiguant et incroyable. Alors c’est la raison pour laquelle le musée va faire une procession. Il s’agit de faire une marche où prendront part 300, voire 400, personnes de couches différentes : hommes, femmes, enfants, jeunes, chercheurs, paysans pour marcher sur 400 mètres. 400 mètres, c’est la distance qui nous sépare de la grande voie au musée. Chacun avec un ustensile en lien avec l’eau : une puisette, une calebasse, un récipient, tout en chantant et en dansant. Ce sera pour mettre en évidence les vertus et valeurs de l’eau, en montrant qu’elle est source de vie, source de cohésion, mais aussi de bénédictions et de création. Voilà un peu ce que l’on veut faire avec cette procession baptisée : « Les porteurs d’eau, porteurs de vérité ». (Celui qui porte l’eau porte la vérité.) Je donne comme exemple l’utilité de l’eau avec nos braves femmes qui nous apportent de l’eau tout le temps à la maison et qui nous aident à assouvir nos besoins réels. Il y aura aussi, en plus des visites guidées que nous allons faire, une activité qui porte sur l’eau et la pêche. Nous disposons d’un étang au niveau du musée. Nous allons demander aux visiteurs de pêcher. L’objectif est de valoriser les valeurs et les vertus de la pêche qui peuvent créer des habitudes comme la patience, l’observation, le regard, l’entraide, la communion avec l’eau.
LNA : M. Samoura, cet espace singulier qu’est le musée de l’eau raconte l’eau sous différents aspects. Pouvez-vous revenir sur sa création ?
Alassane Samoura : la création de ce musée découle d’un constat. Celui de combler un vide patrimonial, un vide culturel, anthropologique, sociologique même. Parce que l’eau est liquide, elle n’est perçue que sous cet aspect . Alors qu’il y a d’autres aspects holistiques qui rentrent en ligne de compte et qui lui donnent une valeur ajoutée après sa fonction vitale. Le musée essaie d’enseigner aux populations les savoirs endogènes, les sciences villageoises, par exemple, comme chercher l’eau avec le bâton du sourcier. Ce patrimoine matériel s’utilise comme le récipient, la calebasse, l’outre pour collecter, puiser l’eau. C’est une manière de le valoriser. Mais aussi celui de valoriser le patrimoine immatériel, notamment les chansons, les mythes, les dictons, les contes et les proverbes. Ensuite, le patrimoine naturel comme les lacs, les rivières et les marigots. Nous pensons important de mettre en exergue l’interrelation qui existe entre eux, entre l’homme les sociétés et les villages ; il est nécessaire d’en parler afin de comprendre le rôle qu’ils jouent dans la cohésion sociale. Je dirais que le musée de l’eau veut que les populations aient une autre vision de voir les choses et les aider à mieux réfléchir.
LNA : l’accès à l’eau potable et l’assainissement restent un problème majeur en Afrique. Quelle est la problématique de l’eau dont souffre le Burkina Faso ?
Alassane Samoura : comme le dit les ODD 6 (objectifs de développement durable) , l’eau et l’assainissement font partie des grandes priorités, comme prévues par les Nations unies. Au Burkina, des progrès ont été notés sur l’accès à l’eau potable avec la réalisation de forages sur le plan communautaire dans les villages et dans ce qu’on appelle les hamos de culture. C’est de grands efforts qui ont été faits dans le cadre de l’accès à l’eau, comme la construction des forages pour les populations, en tenant compte de leurs nombres. Le taux d’accès à l’eau potable dans ces contrées commence à devenir un bon indicateur. Cependant, tel n’est pas le cas dans les grandes villes du fait de la forte pression démographique. La Nationale des eaux s’occupe de l’approvisionnement en eau des populations, mais n’arrive pas à satisfaire jusqu’à présent leurs besoins du fait de cet aspect. Vu que la ville s’agrandit, cela demande beaucoup de moyens pour que les populations accèdent à l’eau. C’est au niveau de l’assainissement que le bât blesse par contre. Le taux est très faible, car il n’y a pas eu de progrès réalisés. Cela est dû un peu aux pesanteurs culturelles. Les gens ont du mal à se défaire de certaines habitudes. Comme par exemple la défécation à l’air libre malgré la construction des latrines. Il faut, à mon avis, faire beaucoup de sensibilisation et de rupture concernant ces facteurs de blocages sociologiques et culturels, les déconstruire afin que les choses évoluent dans le bon sens.
LNA : il était prédit pour 2025 que 25 pays africains feraient face à une pénurie d’eau douce ou de stress hydrique liés aux changements climatiques, à la croissance démographique rapide et à la rareté physique et économique. Quels seraient les impacts sur les populations ?
Alassane Samoura : cela va créer effectivement des impacts très négatifs sur les populations. Une des grandes conséquences est le risque d’une émergence de maladies hydriques, notamment une résurgence de maladies comme le choléra, la dysenterie, la bilharziose. Ce qui serait mortel pour les communautés vulnérables que sont les femmes et les enfants. Les changements climatiques auront aussi comme impact la migration des populations qui vont quitter les zones de sécheresse vers celles susceptibles être riches en eau. Là, le risque reste les conflits entre migrants dans les villes d’accueil . Et là, surgit un autre problème qu’est celui de la gestion de l’espace foncier ou l’acceptation de l’autre, car on estime que celui-ci vient perturber le mode de vie des populations d’accueil. Voici quelques raisons qui montrent que les Africains doivent encore faire des recherches dans la problématique des changements climatiques. Par exemple, planter le maximum d’arbres devant chaque maison. L’arbre joue un grand rôle dans les changements climatiques dans des pays comme le Burkina Faso.