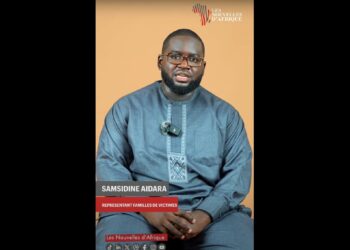La récente décision du président américain Donald Trump de réinscrire le Nigeria sur la liste des « pays particulièrement préoccupants » (CPC) en matière de liberté religieuse suscite de nombreuses interrogations.
Officiellement motivée par une prétendue persécution des chrétiens, cette mesure s’inscrit dans un contexte complexe, mêlant enjeux sécuritaires, tensions identitaires et stratégies d’influence politique.
Une lecture religieuse d’un conflit multidimensionnel
Le Nigeria fait face à une multiplicité de crises sécuritaires : insurrection djihadiste dans le nord-est, conflits entre éleveurs et agriculteurs dans le centre, et violences criminelles dans le nord-ouest.
Ces dynamiques, bien que parfois teintées de considérations religieuses, sont avant tout territoriales, économiques et sociales.
Les affrontements entre éleveurs majoritairement musulmans et agriculteurs souvent chrétiens sont fréquemment interprétés à tort comme des conflits confessionnels, alors qu’ils résultent principalement de la compétition pour la terre et les ressources.
De même, les attaques de groupes djihadistes tels que Boko Haram ou ISWAP visent indifféremment musulmans et chrétiens, selon les données du think tank ACLED, qui qualifie ces violences d’« indiscriminées ».
Des chiffres qui nuancent les accusations
Les statistiques disponibles contredisent en partie le récit d’un génocide ciblé contre les chrétiens.
Entre 2020 et 2025, on dénombre 389 attaques contre des chrétiens (318 morts) et 197 attaques contre des musulmans (418 morts).
Depuis 2009, plus de 52 000 civils ont perdu la vie dans des violences politiques, toutes confessions confondues.
Ces chiffres suggèrent une réalité plus nuancée que celle véhiculée par certains acteurs politiques et religieux, notamment aux États-Unis et en Europe.
Une décision aux relents politiques ?
La désignation du Nigeria comme CPC ne peut être dissociée des pressions politiques internes américaines.
Des figures conservatrices comme Chris Smith, Ted Cruz ou Riley Moore ont multiplié les appels à sanctionner Abuja, s’appuyant sur les rapports d’ONG chrétiennes telles qu’Open Doors ou Global Christian Relief.
Ces organisations, souvent impliquées dans l’évangélisation, ont contribué à façonner l’image d’un Nigeria symbole du martyrologe chrétien mondial.
Par ailleurs, certains groupes séparatistes biafrais, en quête de reconnaissance internationale, ont également instrumentalisé le discours de la persécution religieuse pour gagner en visibilité diplomatique.
Quelles conséquences pour Abuja ?
Cette désignation pourrait entraîner des sanctions économiques ou des restrictions de visas.
En juillet déjà, les États-Unis avaient limité la durée des visas nigérians à trois mois.
Si ces mesures sont officiellement présentées comme une défense de la liberté religieuse, elles risquent surtout de fragiliser davantage un pays confronté à de graves défis sécuritaires, économiques et sociaux.
La décision pourrait aussi tendre les relations diplomatiques entre Abuja et Washington, d’autant que le gouvernement nigérian rejette fermement les accusations.
Elle soulève enfin une interrogation majeure : Dans quelle mesure les préoccupations religieuses sont-elles instrumentalisées à des fins géopolitiques ou électorales ?
B.B