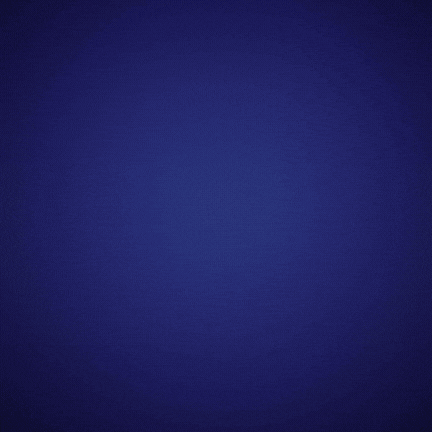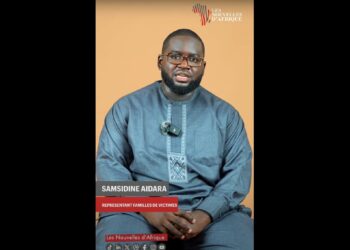Depuis le coup d’État du 18 août 2020, le Mali traverse une crise multidimensionnelle, où instabilité politique, effondrement institutionnel et expansion djihadiste s’entrelacent. La junte militaire dirigée par le général Assimi Goïta a suspendu la transition démocratique et instauré un régime autocratique. Cette configuration a involontairement facilité l’implantation du GSIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), affilié à Al-Qaïda. Le contrôle territorial, économique et technologique exercé par le GSIM menace non seulement le Mali mais l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest.
Gouvernance parallèle et usage des technologies
Le GSIM impose une gouvernance efficace via les téléphones portables et les messages chiffrés pour coordonner ses opérations et surveiller les populations[^1]. Des drones commerciaux détournés assurent une surveillance ponctuelle, transformant le territoire en État parallèle sans présence militaire constante. Bamako, capitale de la République, perd toute autorité effective sur plus de 70 % du territoire rural.
Expansion territoriale et conséquences économiques régionales
Près de 19 % des approvisionnements en carburant destinés à Bamako passent par des corridors contrôlés ou menacés par le GSIM. Les pays de transit – Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin, Niger et Mauritanie – subissent des perturbations logistiques, une hausse des prix de 15 à 20 % et une fragilisation économique[^2]. Chaque station-service fermée ou camion immobilisé devient un levier stratégique, paralysant commerce et services essentiels.
Fragilisation du Chérif de Nioro et autorité morale
Bouyé Haïdara, Chérif de Nioro-du-Sahel, voit son autorité religieuse et morale s’éroder face à la progression du GSIM[^3]. Cette fragilisation réduit la capacité de médiation traditionnelle, laissant le champ libre aux factions djihadistes et facilitant l’implantation de califats pilotes.
Éducation et crise énergétique
Près de 40 % des écoles dans les zones touchées sont fermées, privant plus de 750 000 enfants d’éducation[^4]. Le manque de carburant amplifie cette crise : déplacements scolaires et enseignants impossibles, cantines fermées, services de santé associés interrompus. L’éducation devient victime indirecte mais stratégique de la domination énergétique du GSIM, augmentant le risque de marginalisation et de radicalisation de la jeunesse.
Conséquences humanitaires
1,3 million de déplacés internes.
800 000 réfugiés ruraux déplacés par l’occupation djihadiste.
Hausse de la malnutrition infantile de 12 % dans Mopti et Ségou.
Accès aux soins limité par le déplacement du personnel et la fermeture d’établissements.
Blocage des transports humanitaires, retardant l’acheminement de vivres et médicaments.
Ces chiffres traduisent une vulnérabilité structurelle accrue par l’incapacité de l’État à maintenir ses fonctions essentielles.
Perspectives de médiation
Axes stratégiques envisageables :
1. Médiation régionale : sécurisation des corridors de carburant via le Sénégal et le Niger.
2. Restauration de l’autorité religieuse : appui au Chérif de Nioro et aux leaders traditionnels pour négocier trêves locales.
3. Sécurisation économique et humanitaire : création de corridors protégés pour carburant et biens essentiels.
4. Médiation technologique : dialogues sécurisés avec certaines factions du GSIM.
5. Coordination multilatérale : forces régionales et internationales pour restaurer l’autorité étatique.
Toutefois, l’entêtement de la junte malienne pourrait limiter l’efficacité de ces actions, car elle risque de rejeter toute médiation qui ne renforcerait pas directement son pouvoir.
Le Mali est paralysé par la conjonction d’une junte obsédée par le pouvoir et d’un GSIM technologiquement avancé. La fermeture des écoles, la crise énergétique, la fragilisation du Chérif de Nioro et les impacts économiques régionaux accentuent la vulnérabilité humanitaire. Sans intervention coordonnée, multidimensionnelle et audacieuse, le pays risque un chaos prolongé, laissant au GSIM la capacité d’imposer durablement son ordre. L’entêtement de la junte à refuser toute médiation non-alignée pourrait transformer cette crise en domination djihadiste prolongée.
Sadio Morel-Kanté, Journaliste/chercheure associée a L’IPSE







![[OPINION]- 𝗡𝗢𝗢𝗢𝗢𝗡, 𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱?????](https://lesnouvellesdafrique.info/wp-content/uploads/2025/12/a56fb065-032e-430a-aeaf-e722267e7920-350x250.jpg)