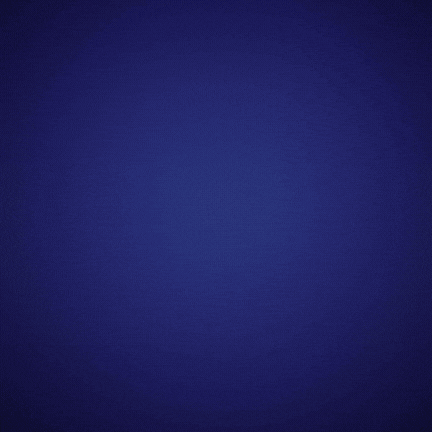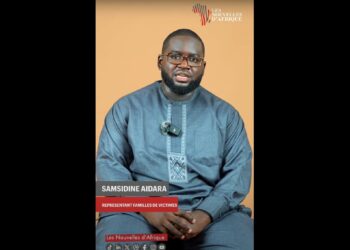Le 8 octobre 2025, le président Mahamat Idriss Déby Itno a promulgué une version révisée de la Constitution tchadienne, adoptée cinq jours plus tôt par un Congrès largement dominé par ses partisans. Derrière ce geste institutionnel en apparence ordinaire se dessine en réalité une consolidation du pouvoir personnel, avec des implications majeures pour l’avenir démocratique du pays.
Une réforme adoptée sans véritable débat
Réunie le 3 octobre, l’assemblée parlementaire, composée de députés et de sénateurs, a validé à une écrasante majorité (236 voix pour, 3 abstentions, aucun vote contre) le nouveau texte. Mais ce chiffre flatteur masque une réalité politique plus sombre : les élus de l’opposition ont quitté la salle avant le vote, dénonçant une manœuvre de légitimation d’un pouvoir sans contrepoids.
Le sénateur Mbaigolmem Sébastien, président intérimaire de l’opposition parlementaire, a dénoncé ce qu’il qualifie de « verrouillage institutionnel et électoral ». Selon lui, cette réforme constitutionnelle représente « la fin de l’alternance » et « un coup d’arrêt au processus démocratique entamé de longue date mais jamais achevé ».
Un mandat de sept ans, sans limite de renouvellement
La mesure la plus controversée du nouveau texte est sans conteste l’instauration d’un mandat présidentiel de sept ans, renouvelable indéfiniment. Autrement dit, Mahamat Idriss Déby Itno pourrait, s’il le souhaite et s’il garde la main sur les leviers du pouvoir, rester à la tête du pays pour plusieurs décennies.
Il s’agit là d’un virage majeur dans l’histoire institutionnelle du Tchad, qui avait pourtant connu, ces dernières années, des tentatives d’ouverture démocratique, bien que limitées et souvent contrariées par les réalités du pouvoir.
La Constitution précédente, promulguée en décembre 2023, issue elle-même d’un processus de transition post-crise, fixait déjà un cadre contesté. Mais cette révision va plus loin encore, en supprimant l’une des dernières barrières symboliques à la perpétuation du pouvoir : la limitation des mandats.
Un président devenu politique
Autre changement significatif : la levée de l’incompatibilité entre la fonction présidentielle et l’engagement partisan. Le président pourra désormais diriger un parti politique tout en exerçant ses fonctions, brouillant encore davantage la frontière entre l’État et la majorité présidentielle.
Cela renforce la capacité du pouvoir en place à utiliser les structures de l’État à des fins électorales, un phénomène déjà bien ancré dans les pratiques politiques tchadiennes. Pour de nombreux observateurs, cette mesure officialise une confusion des rôles déjà constatée de facto.
Une Constitution façonnée sur mesure
Pour ses détracteurs, cette réforme n’est ni plus ni moins qu’une Constitution taillée sur mesure pour le président Déby. Le député Béral Mbaikoubou parle d’un « passage en force », estimant que le texte a été modifié non pour répondre aux besoins du peuple, mais pour assurer la pérennité d’un régime fortement centralisé autour de la figure présidentielle.
Depuis son arrivée au pouvoir en avril 2021, à la suite du décès brutal de son père Idriss Déby Itno, Mahamat Déby dirige le pays avec le soutien de l’armée et de ses alliés politiques. Officiellement en transition pendant plusieurs années, le régime a progressivement écarté les scénarios d’alternance ou de réelle ouverture démocratique.
Des risques pour la stabilité
Les conséquences pourraient être catastrophiques pour le pays. La réforme risque d’exacerber les tensions avec les forces d’opposition et la société civile, déjà affaiblies par des années de répression et de marginalisation politique. Elle pourrait également raviver les frustrations régionales, dans un pays historiquement fragmenté entre nord et sud, entre centre et périphérie.