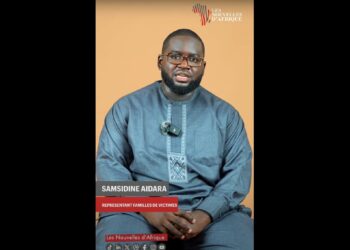Deux ans d’existence, mais les cœurs ne sont pas à la fête. Ce mardi 16 septembre, l’Alliance des États du Sahel (AES) souffle sa deuxième bougie. Entre sécession et isolement, ces États, désormais dirigés par des gouvernements militaires, continuent de faire face à d’énormes défis, notamment en matière de sécurité et de développement socio-économique.
Naissance et rupture
Créée le 16 septembre 2023, l’Alliance des États du Sahel a été fondée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Droits dans leurs bottes, en treillis, ce jour-là, les chefs militaires de ces trois pays — Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahamane Tiani — ont signé la « Charte du Liptako-Gourma » pour instituer une alliance de défense collective et d’assistance mutuelle. Cette union a été scellée en plein bras de fer avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Conséquence : le 28 janvier 2024, les trois pays de l’AES ont annoncé leur intention de quitter la CEDEAO, une décision qui a été officialisée dès le lendemain. Cette rupture a eu des conséquences géopolitiques, économiques et sociales profondes. Malgré les tentatives de négociation et les propositions de concessions de la part de la CEDEAO, les trois membres de l’AES ont mis leur menace à exécution.
Dans un communiqué du 29 janvier 2024, la CEDEAO a confirmé que le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger était devenu effectif. Cependant, dans un esprit de solidarité régionale, elle a demandé à ses États membres de continuer à accorder aux citoyens des trois pays le droit de libre circulation et d’établissement sans visa, conformément aux protocoles existants.
Le défi sécuritaire et le coût de l’isolement
Malgré la création de l’AES, ces États sont toujours confrontés à un immense défi sécuritaire. Ils restent la cible de groupes armés qui continuent de menacer la stabilité que les régimes militaires tentent d’installer. Comme l’a souligné le Représentant spécial des Nations unies, les activités terroristes sont de plus en plus complexes et sophistiquées, avec l’utilisation de drones, aggravant ainsi une situation humanitaire déjà critique.
En deux ans, les défis de l’AES restent considérables : la sécurité des populations n’est pas garantie, les économies des pays sont instables et les libertés individuelles sont loin d’être acquises. Le Niger tousse, le Burkina Faso a le rhume, le Mali développe des symptômes inquiétants. Trois pays face à l’hydre du JNIM qui continue de multiplier les attaques et d’avancer ses pions. Si l’Alliance a « dégagé » la France pour dérouler le tapis rouge à la Russie, la situation est peu reluisante surtout dans le domaine sécuritaire. Depuis 2023, les terroristes mènent la terreur dans des zones stratégiques. Dernière illustration, la « guerre économique » menée par le JNIM à Kayes, au Mali.
Les paradoxes économiques
En décidant de s’éloigner de la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont voulu créer une coopération régionale axée sur leurs besoins spécifiques en matière de sécurité et de développement, besoins que l’organisation ouest-africaine n’aurait pas su satisfaire.
Toutefois, comme le note l’analyste économique Honoré Mondomobé, ce retrait semble avoir été précipité. « Ce n’est pas une sortie mûrement préparée », explique-t-il, soulignant que cette précipitation n’a pas laissé le temps aux pays de se préparer à la création d’une monnaie ou d’un espace de libre-échange. Pour l’heure, les trois nations restent membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), car la création d’une nouvelle monnaie exige des règles strictes que ces pays, encore fragiles financièrement, ne sont pas en mesure de respecter.
Les ressources minières en jeu
Les relations entre les gouvernements militaires et les multinationales qui exploitent les ressources minières du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont tendues. Les juntes ont engagé des processus de nationalisation et de renégociation des contrats, estimant que leurs pays ne tirent pas un profit suffisant de leurs propres richesses. Les accusations de favoritisme envers les intérêts étrangers au détriment des populations locales se multiplient.
Dans le but d’augmenter les revenus de l’État, les dirigeants de l’AES ont commencé à réviser les codes miniers, à renégocier les accords et à envisager la création de sociétés minières d’État. L’enjeu est de taille : mieux exploiter leurs ressources pour financer leur développement et consolider leurs régimes.